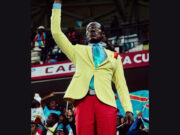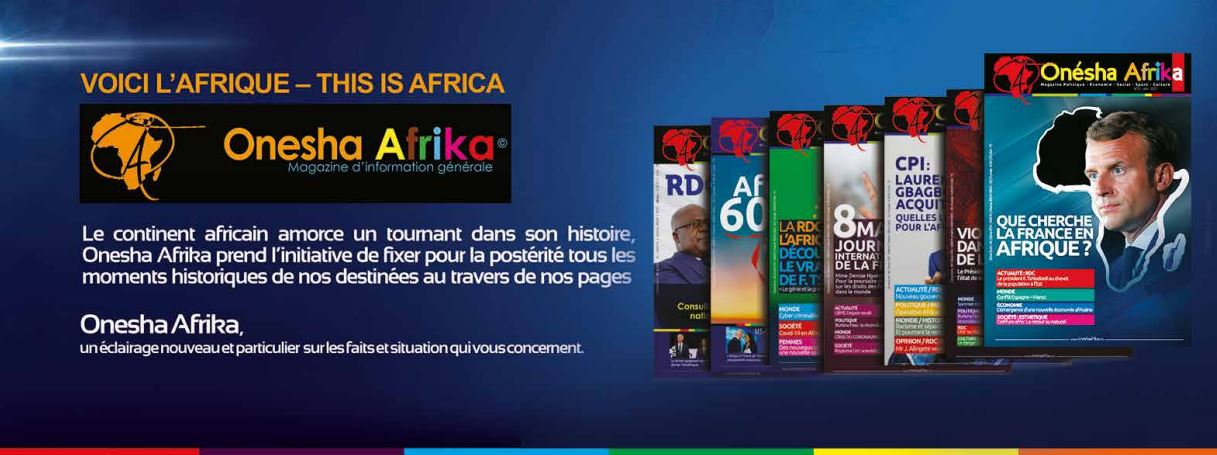Le président ghanéen Nana Akufo Addo relance, pour la énième fois, le débat sur les réparations aux victimes de l’esclavage. C’était lors d’un sommet consacré aux conséquences de l’esclavage en août 2022.
Pour le chef de l’État ghanéen en effet, « il est temps que l’Afrique, dont 20 millions de fils et de filles ont vu leurs libertés réduites et ont été vendus comme esclaves, reçoive également des réparations». S’il estime qu’aucune somme d’argent ne pourra réparer les dommages de la traite négrière, Nana Akufo-Addo considère que c’est à l’Union Africaine de se mobiliser.
La question des réparations n’est pas nouvelle. Elle s’est posée en même temps que celle des abolitions de l’esclavage. Ainsi, en 1865, aux États-Unis, juste après l’abolition, un ordre militaire a prévu la confiscation de 1 600 km2 de terres le long de la côte atlantique. Chaque esclave affranchi devait recevoir 16 hectares. Mais une forte opposition des élites blanches a bloqué le processus.
Toujours aux États-Unis, la banque JP Morgan, dont le capital est en partie issu de l’esclavage, devait, suite au vote d’une loi en 2005, financer des bourses pour les étudiants noirs de la ville de Chicago. Au Royaume-Uni, des universités ont également proposé des aides aux étudiants originaires des Caraïbes.
Guérir les torts du passé
Lors du sommet, le président ghanéen a rappelé les effets dévastateurs de la traite des esclaves pour le continent, ajoutant que cette période a retardé le progrès économique, culturel et psychologique de l’Afrique. « Les dommages causés par la traite des esclaves et ses conséquences se sont étendus sur plusieurs siècles. Nous devons guérir des torts du passé », affirme encore le président ghanéen.
Nana Akufo-Addo estime que l’ensemble du continent mérite des excuses de la part des nations européennes impliquées dans cette traite des esclaves. Il exhorte l’Union africaine à s’engager avec les Africains de la diaspora et à former un front uni pour faire avancer la cause des réparations.
Une lutte de longue haleine
La question des réparations pour les victimes de l’esclavage n’est pas nouvelle, remarque l’historienne Miriam Cotthias. Elle a été abordée dès le début du XXème siècle par des leaders panafricains. Elle est ensuite revenue de façon récurrente, portée à la fois par des Afro-Américains aux États-Unis que par le mouvement abolitionniste européen, sans jamais aboutir totalement.
« Il y a eu des pays leaders comme la Jamaïque, qui a créé la commission sur les réparations et qui a fédéré tous les États caribéens autour de cette demande, en déterminant dix points principaux qui étaient nécessaires pour le développement de ces anciennes colonies esclavagistes, rappelle encore l’historienne.
« Mais du côté africain, cela n’a jamais été posé de façon aussi rigoureuse et tranchée. » En Jamaïque, depuis 2009, une commission est mise en place, laquelle interroge sur les moyens d’apporter des réparations : transferts de compétences pour faciliter le développement et annulation de la dette notamment. Pour le moment, les demandes de l’État n’ont rien donné. En Colombie, autre stratégie, les communautés noires n’exigent pas d’argent, mais défendent l’accès aux terres et à l’éducation.
En France, la loi Taubira, adoptée en 2001, reconnaît l’esclavage comme un crime contre l’humanité, mais toutes les demandes formelles de réparations n’ont pas été conservées dans le texte adopté à l’Assemblée nationale. Les plaintes déposées, par exemple en 2013 par le Cran, le Conseil représentatif des associations noires de France, contre l’État et la Caisse des dépôts, accusés de « complicité de crime contre l’humanité », n’ont pas abouti.
Partout dans le monde, les mouvements qui se battent pour des réparations n’ont d’ailleurs jamais obtenu un seul centime d’un État par la voie judiciaire. Pour l’historienne Giulia Bonacci, chargée de recherche à l’Institut de recherche pour le développement, le débat sur les réparations liées à l’esclavage est bien évidemment politique.