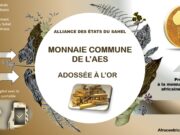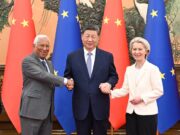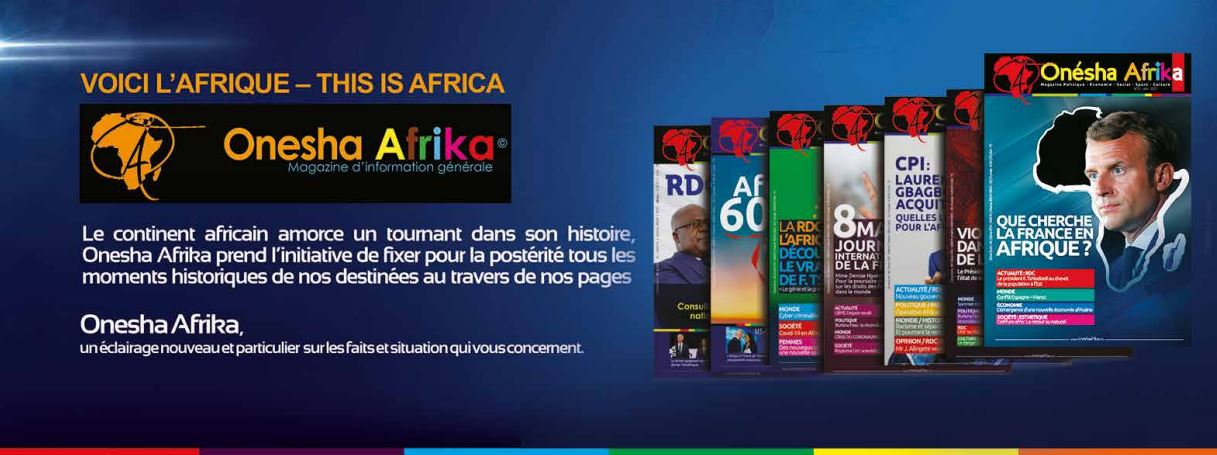De quoi rêvent les jeunes étudiantes de Kinshasa pour leur avenir ? Entre ambitions personnelles et volonté de faire bouger les lignes, un quotidien kinois a promené son micro-baladeur le 13 mai sur plusieurs établissements d’enseignement supérieur, à la rencontre de ces jeunes dames.
Pour Gradie Lelo, 22 ans et étudiante en 4ème année de Médecine à l’Université de Kinshasa : « Dans cinq ans, je me vois médecin, spécialisée en gynécologie. J’aimerais ouvrir une petite clinique dans la commune de Masina où j’ai grandi. Beaucoup de femmes là-bas n’ont pas accès à des soins de qualité, surtout en santé maternelle. Ce n’est pas juste et je veux contribuer à changer ça ».
Djamila Ambu, 21 ans, étudiante en Gestion à la Haute école de Commerce, anciennement Institut supérieur de Commerce (ISC), veut pour sa part se lancer dans l’entrepreneuriat : « Je suis passionnée par les produits naturels. Je veux créer une marque de cosmétiques made in Congo, avec des ingrédients locaux. Mon rêve est d’exporter mes produits un jour et d’offrir des emplois à d’autres jeunes femmes. Je veux être indépendante et utile ».
Quant à Merveille iyogo, 23 ans, en Droit à l’Université protestante du Congo, l’avenir se conjugue avec engagement : « Je veux devenir avocate spécialisée en Droit des femmes. Trop de filles subissent des injustices graves sans pouvoir se défendre. Je veux leur tendre la main. Dans cinq ans, je me vois plaider dans des tribunaux, défendre des causes justes. C’est plus qu’un rêve, c’est une mission pour moi ».
Jouer un rôle dans la valorisation des femmes
Sur le campus de l’Université de Kinshasa, Patricia Rusha, étudiante en Communication, aspire à devenir journaliste : « Dans cinq ans, je veux être à la télévision, pas seulement comme présentatrice, mais comme femme qui propose des contenus valorisant la femme congolaise. On a besoin de voir plus de femmes à l’écran, dans des rôles de décision. Moi, je veux inspirer, comme certaines femmes journalistes m’ont inspirée ».
De son côté, Clarisse Mupemba, 20 ans et étudiante en Informatique à l’Institut supérieur des Techniques appliquées (ISTA), veut intégrer la high tech : « Je rêve de créer une application mobile pour aider les petites vendeuses des marchés à mieux gérer leurs finances. Beaucoup de femmes travaillent dur sans jamais avoir un vrai suivi de leurs revenus. Avec la technologie, on peut les aider concrètement. Je veux montrer qu’une femme peut aussi coder et innover ».
Rachel Banza, 22 ans, étudiante en Agronomie à l’Université de Kinshasa, pense révolutionner l’agriculture urbaine : « J’ai grandi dans la commune de Limete1 et j’ai toujours vu des terrains vides ou mal utilisés. Mon rêve est de développer des potagers urbains, avec des techniques écologiques et peu coûteuses. On pourrait nourrir les quartiers, créer des emplois et même éduquer les enfants à l’écologie. C’est local et utile ».
Réussir et impacter la société

Ainsi, si les aspirations varient selon les cursus, toutes les jeunes dames interrogées ont en commun la soif de réussir et d’impacter leur société. Certaines d’entre elles évoquent aussi les obstacles qu’elles doivent surmonter, allant de la pression familiale aux stéréotypes de genre, en passant par le manque de financement ou d’encadrement professionnel.
Stella Nakwal, 24 ans et étudiante en Économie, fait ainsi remarquer : « J’ai de grands rêves, mais je sais aussi que le chemin est long. C’est pour cela que je cherche à me construire un réseau, à suivre des formations en dehors de mon cursus. Être une femme ambitieuse, c’est un combat de tous les jours. Mais je suis prête à me battre ».
Autant de témoignages qui montrent que les étudiantes congolaise ne manquent de détermination. Elles veulent être plus que de simples diplômées, des actrices du changement, des femmes autonomes, visibles et influentes.
L’hypogamie, de plus en plus populaire chez les femmes intellectuelles

Aux États-Unis comme en Europe, l’hypogamie est de plus en plus populaire chez les femmes. Mais de quoi s’agit-il ? Selon le site mariefrance.fr, les rapports des femmes avec les hommes ont profondément évolué. Elles sont de plus en plus à revendiquer leur indépendance, questionnent les modèles classiques de couple et dissocient leur épanouissement personnel de leur rôle de partenaire.
Si le modèle de la Trad wife, qui prône un retour aux rôles domestiques traditionnels pour les femmes, a connu une certaine percée sur les réseaux sociaux, il reste à la marge.
Selon un sondage Ifop mené en juillet dernier, plus des deux tiers (68%) des femmes ne souhaitent pas se mettre en couple avec un homme ayant une vision traditionnelle des rôles de genre. Il s’agit d’une vision du couple où les rôles des hommes et des femmes sont clairement distincts.
Ainsi, l’homme est perçu comme le pourvoyeur principal, responsable des finances et des décisions majeures. La femme, elle, s’astreint aux tâches domestiques, à l’éducation des enfants et à un rôle de soutien.
De plus en plus de femmes se tournent vers l’hypogamie
Très peu pour ces femmes qui vont à l’encontre du modèle « naturel » de l’hypergamie, qui est une pratique sociale consistant à se marier ou à nouer une relation avec une personne ayant une situation financière, sociologique ou éducative supérieure. Historiquement, ce schéma voyait les femmes chercher des partenaires mieux positionnés socialement pour assurer leur sécurité économique.
La nouvelle « tendance » en matière de relation, c’est de se tourner vers l’inverse : l’hypogamie. Les études de Christine Schwartz, professeure de Sociologie à l’Université du Wisconsin, illustrent cette évolution nette qui s’est jouée en quelques décennies au sein du couple hétérosexuel.
Si auparavant, les hommes étaient nombreux à se mettre en couple avec une femme qui était moins diplômée qu’eux, aujourd’hui, ce serait précisément l’inverse. L’hypogamie, c’est ça : s’unir à une personne ayant un niveau d’éducation inférieur.
En 1980, 39% des Américaines étaient hypogames. En 2020, ce pourcentage a grimpé à 62% dans les couples hétérosexuels. Ainsi, la majorité des femmes sont désormais en couple avec des hommes moins diplômés. Ce phénomène s’explique notamment par le fait qu’elles décrochent plus de diplômes que les hommes.
Les femmes ajustent leurs critères
Il n’y a pas qu’aux États-Unis qu’amour et diplômes se dissocient. La même bascule s’est produite en Europe. Selon une étude de l’Institut européen pour l’égalité des genres (EIGE, 2022), les femmes représentent dorénavant plus de 54% des diplômés universitaires dans l’Union européenne, contre seulement 46% pour les hommes.
Mais on ne peut uniquement attribuer la montée de l’hypogamie à un changement des mentalités. En effet, plusieurs études suggèrent que ce modèle n’est pas vraiment un choix, mais plutôt une adaptation. En d’autres termes, face à une pénurie d’hommes ayant le même niveau d’éducation, les femmes ajustent leurs critères. « Les préférences ne sont pas figées, les gens réagissent rapidement à la disponibilité des partenaires », souligne Christine Schwart.