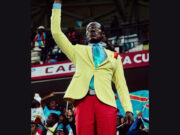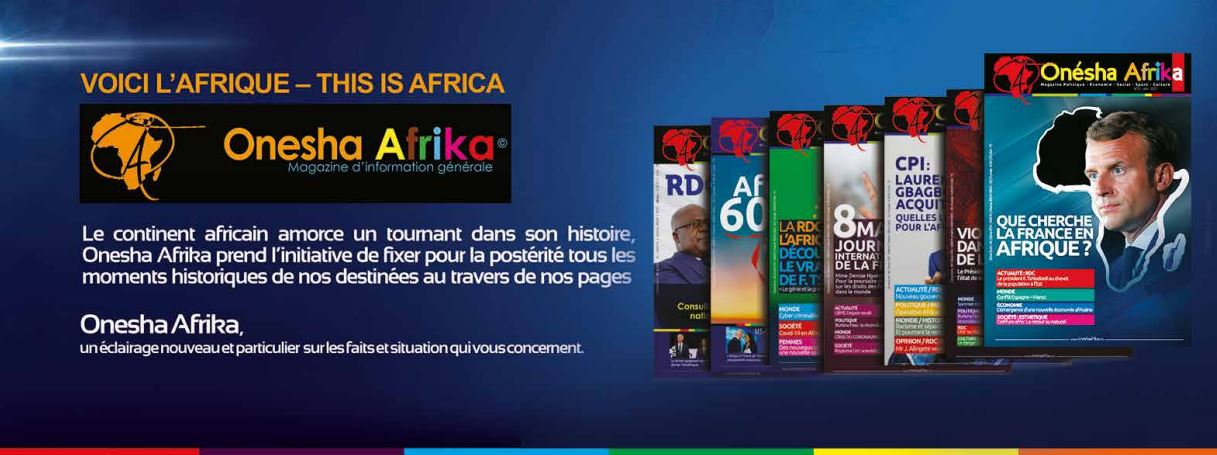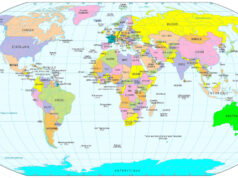Les Belges comptent différemment des Français avec « septante » et « nonante ». Cette particularité révèle l’histoire passionnante du français européen. La langue française résonne différemment selon les pays où elle s’épanouit. Traverser la frontière franco-belge révèle immédiatement des nuances linguistiques surprenantes. En effet, les chiffres constituent l’exemple le plus frappant de ces divergences.
Pourquoi le français de France est-il parfois confronté aux variantes belges ? Cette différence apparemment anodine cache pourtant une riche histoire et une richesse linguistique méconnues. Cette histoire révèle les multiples visages du français de France et d’ailleurs.
Le français de France s’enrichit constamment au contact des variantes régionales et nationales. En Belgique francophone, plus de 4 millions de locuteurs développent leurs propres spécificités linguistiques. Ces belgicismes ne constituent nullement des erreurs de langue mais témoignent d’une évolution parallèle fascinante. Les linguistes reconnaissent désormais ces variations comme légitimes et créatrices de richesse. D’ailleurs, l’Office québécois de la langue française valide cette diversité francophone mondiale. Cette reconnaissance officielle encourage les recherches sur les particularités régionales du français contemporain.
En outre, la proximité géographique entre la France et la Belgique facilite les échanges linguistiques quotidiens. Cependant, le français de France conserve ses particularités historiques tandis que le français belge développe ses propres innovations. Les médias belges influencent progressivement le lexique français grâce aux émissions télévisées transfrontalières. Cette coexistence harmonieuse illustre parfaitement la diversité dynamique de notre langue commune. Par conséquent, l’espace francophone européen témoigne d’une vitalité linguistique exceptionnelle qui dépasse les frontières nationales traditionnelles.
Le français de France privilégie un système vigésimal hérité du Moyen-Âge pour certains nombres. Ce système, basé sur vingt, explique l’expression « quatre-vingts » (quatre fois vingt). Les marchands médiévaux comptaient par vingtaines, influençant durablement notre numération française actuelle. Au XVIIème siècle, l’Académie française généralise ce modèle complexe et impose « soixante-dix » dans l’Hexagone. Cette décision académique visait l’uniformisation linguistique mais créait paradoxalement des difficultés d’apprentissage. Néanmoins, la tradition vigésimale française persiste encore aujourd’hui dans l’enseignement scolaire national.
L’origine historique des systèmes de numération, vigésimal contre décimal
En revanche, la Belgique et la Suisse conservent le système décimal logique et mathématique. « Septante » provient directement du latin « septuaginta », témoignant d’une filiation étymologique claire. Cette logique arithmétique séduit les autorités éducatives belges dès le XIXème siècle européen. Par ailleurs, les pédagogues suisses adoptent également ce système pour faciliter l’apprentissage numérique. En dehors de « septante », on entendra donc dire dans certaines parties de Suisse « octante » pour « quatre-vingts » en France. Par conséquent, le français de France maintient sa complexité historique face à la simplicité pragmatique des variantes belge et suisse contemporaines.
Le français de France côtoie d’autres variantes francophones enrichissantes dans le monde entier. Au Québec, environ 7 millions de francophones développent leurs spécificités linguistiques distinctes et créatives. Ainsi, les Québécois utilisent « stationnement » contre « parking » français, « courriel » contre « mail » hexagonal. Cette créativité lexicale québécoise inspire d’ailleurs les terminologues européens dans leurs recherches contemporaines. En outre, le Québec produit des néologismes techniques remarquables pour contrer l’anglicisation massive. Cette résistance linguistique québécoise influence positivement les politiques linguistiques françaises actuelles.
L’influence anglophone marque profondément le français québécois avec des mots comme « cellulaire » ou « magasiner ». En Afrique subsaharienne, 47,4% des francophones mondiaux enrichissent continuellement notre langue commune.
Le mot « Liboke » adopté par la langue française

Les écrivains africains créent des expressions poétiques qui renouvellent le vocabulaire littéraire. De plus, les médias africains popularisent des tournures syntaxiques originales à travers leurs productions. Le mot « liboke », à savoir un repas fait de poisson parfois de viande et cuit sur un feu de braise enveloppé dans des feuilles, plus récemment adopté par la langue française, est éloquent. Finalement, le français de France rayonne à travers ces multiples variations dynamiques qui témoignent de sa vitalité planétaire exceptionnelle.