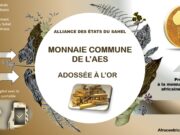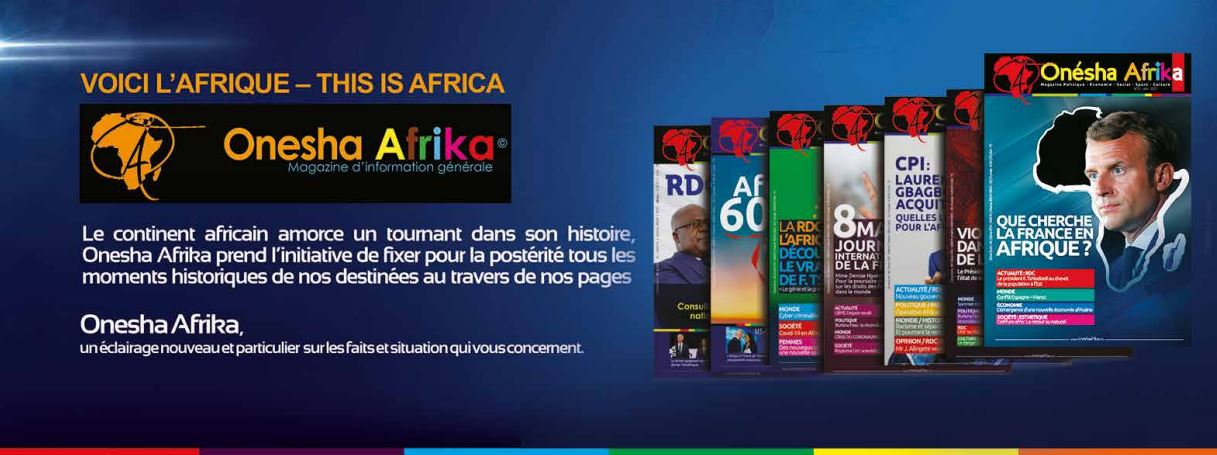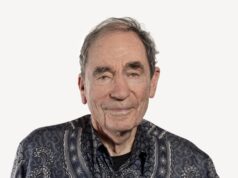Un procès en appel dans lequel l’État belge est cité en justice pour répondre de sa politique raciale durant la colonisation au Congo entre 1908 et 1960 s’est tenu les 9 et 10 septembre à Bruxelles. Cinq femmes métisses enlevées à leurs familles à la naissance portent plainte pour enlèvement, ségrégation et crime contre l’humanité.
À la base de cette action au civil se trouvent cinq femmes métisses qui ont été victimes de l’enlèvement et de la ségrégation des très jeunes enfants métis au Congo. Elles demandent que la justice condamne l’État belge pour avoir organisé ce système violent de discrimination raciale aux lourdes conséquences sur leur vie », aux termes de la citation.
Cette plainte, qui est une première du genre en Europe, avait été plaidée en première instance en 2021. Le tribunal civil de Bruxelles avait rejeté la demande des cinq requérantes, la défense ayant plaidé que les faits n’étaient pas constitutifs d’infraction au moment de la commission et que les enfants étaient soustraits pour leur assurer une meilleure éducation. Les plaignantes ne sont pas de cet avis. Elles ont donc interjeté appel.
Les cinq femmes nées au Congo entre 1946 et 1950 attaquent l’État belge en responsabilité civile pour crime contre l’humanité. Elles lui réclament des dommages et intérêts pour l’important préjudice causé lorsqu’elles ont été enlevées et ségréguées. Elles sollicitent aussi la production d’archives concernant leurs origines et leur histoire.
Nées de l’union d’un Belge et d’une Congolaise, durant la période où le Congo était colonie belge, elles ont été arrachées à leur foyer pour être placées de force dans des orphelinats, comme la plupart des très jeunes enfants métis.
20 000 enfants, enlevés à bas-âge, sont concernés
Selon des documents officiels issus des archives coloniales, dévoilés par les avocats des plaignantes, des rapts d’enfants métis ont été organisés par des officiers de l’État belge et mis en œuvre avec le concours de l’Église. Les fonctionnaires de l’État colonisateur recevaient des instructions pour organiser les enlèvements des enfants issus d’une union mixte, en contraignant les mères à se séparer d’eux. Les enfants étaient placés dans des missions catholiques qui se trouvaient sur le territoire du Congo belge, mais aussi au Rwanda, loin de chez eux.
Dès leur plus jeune âge – de quelques mois à cinq ans – les métis ont ainsi été arrachés à leur mère et à leur village natal par le recours à la force, aux menaces ou à des manœuvres trompeuses alors que ces enfants n’étaient ni abandonnés ni délaissés, ni orphelins ni trouvés, ont plaidé les avocats des victimes.
On estime que 20 000 enfants métis ont subi le même sort. Le dernier mot revient ainsi à la Cour d’appel de Bruxelles, qui devra trancher d’ici décembre.
En 2018, Charles Michel, alors Premier ministre, avait présenté ses excuses au nom de la Belgique. Pour les plaignantes, les excuses sont une première étape, la seconde étant de réparer le dommage causé.
Le témoignage des victimes

Les cinq Belgo-congolaises, aujourd’hui septuagénaires, sont Lea Tavares Mujinga, Monique Bitu Bingi, Simone Vandenbroecke Ngalula, Noëlle Verbeken et Marie-José Loshi.
Dans une déclaration en octobre 2021, Léa Tavares Mujinga raconte qu’elle a pu voir son père, par hasard, alors qu’elle avait 14 ans. « J’ai vu un monsieur qui me ressemblait. Je lui ai dit : « bonjour monsieur «. Il a pleuré. Il voulait me prendre dans les bras. Il m’a dit : « je ne voulais pas t’abandonner «. Il était rentré au Portugal pour préparer mon arrivée. Quand il est revenu, j’avais été enlevée, et il ne savait pas où j’étais ».
Monique Bitu Bingi, elle, est plus expansive. Selon elle, aucun Métis de la colonisation ne s’est vu offrir une éducation adéquate. « On était dans un centre et les grandes filles s’occupaient des plus petites. On allait dans la même classe avec les autres enfants du village, on marchait pieds nus comme eux, on mangeait encore plus mal. Alors quelle est l’éducation qu’on nous a donnée de plus que les autres ? » questionne-t-elle.
« J’avais 4 ans. Ma mère, mes tantes, mon oncle et mon grand-père ont été obligés de me conduire à la mission catholique. Je me souviens de tout. Un agent territorial nous a conduits à Katende. Là, je me suis retrouvée dans la foule d’un grand mariage, et je ne voyais plus mes parents. Une des fillettes du couvent, qui avait huit ans, m’a portée pour me mettre au lit. Le lendemain, j’étais avec les autres filles. Les plus grandes, entre 8 et 11 ans, s’occupaient des plus petites », ajoute Monique Bitu.
« Nous avons été abandonnés à l’indépendance »
En 1960 et les troubles qui ont suivi, les Belges ont plié bagage. « Quelques jours après l’indépendance, j’avais 11 ans, nous sommes parties avec les sœurs pour rejoindre la mission de Saint-Antoine. Là, on nous a donné des badges avec nos noms et nos dates de naissance pour partir en Belgique. Arrivés à l’aéroport, ils ont pris toutes les bonnes sœurs, mais pas les enfants. On nous a ramenées à Lusambo puis reparties dans des familles d’accueil, chez de vieilles mamans qui n’avaient rien. Nous avons été détruites moralement et physiquement », explique Mme Bitu.
Elle poursuit : « Ma mère était autorisée à venir me voir une fois par an, pour deux jours. Mais elle s’était mariée et avait d’autres enfants. Quand les troubles ont cessé, un prêtre hollandais et un abbé sont venus nous chercher pour nous mettre à l’école. Mais nous étions devenues d’autres personnes ».
Arrivée en Belgique à 32 ans avec ses enfants, ce n’est qu’à 65 ans que Monique Bitu a finalement retrouvé la famille de son père, parti en Argentine, où il a eu d’autres enfants.
« Avec un simple pardon ou des regrets, l’État peut-il corriger notre vie ? Peut-il me rendre l’amour qui m’a manqué toute ma vie ? Non. Il doit reconnaître ce qu’il nous a fait ».
Un dédommagement de 50 000 euros a été sollicité par plaignante. « Il s’agit d’une somme provisionnelle et symbolique, qui correspond à ce que l’on demande lorsqu’un crime est commis », explique Me Michèle Hirsch, l’un des quatre avocats de la défense. Un expert doit évaluer la réalité et le montant du préjudice subi.