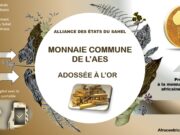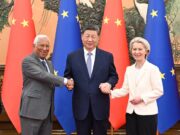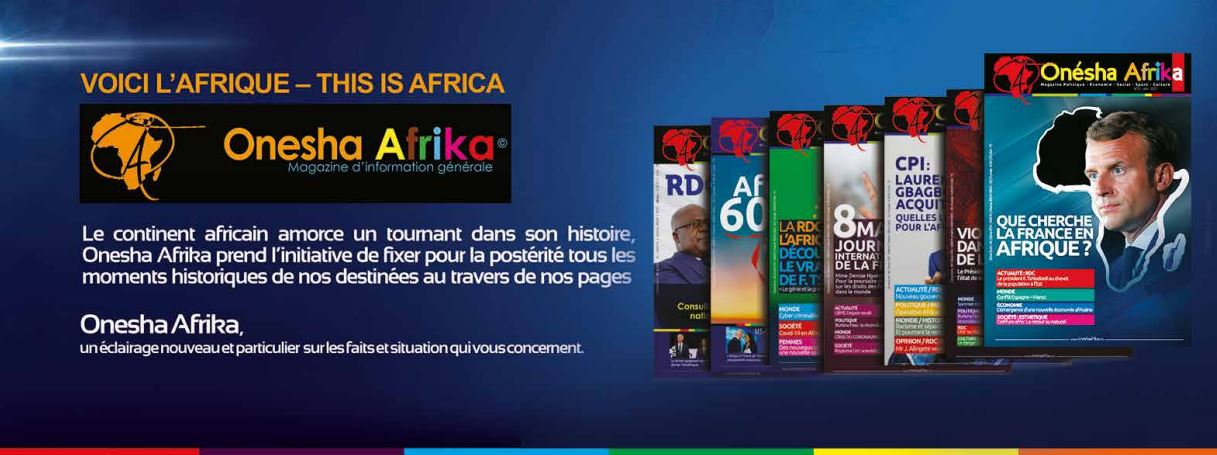Pekin a annoncé son méga-projet de construction d’une centrale hydroélectrique au Tibet, la plus puissante au monde d’une capacité installée de 60 GW, soit près du triple de celle des Trois Gjorges, l’actuelle puis puissante du monde, et ce sous l’œil inquiet des observateurs occidentaux. Et pour cause ?
Avec une économie chinoise déjà largement approvisionnée en énergie bon marché, y compris en gaz naturel russe à moindre coût, la Chine est loin d’être satisfaite de ses prouesses.
Située dans la chaîne himalayenne sur le fleuve Yarlung Tsangpo, la future méga-centrale chinoise dont l’investissement est estimé à 125 milliards d’euros, devrait être mise en service pour 2035. Elle permettra à la Chine d’ajouter 300 TWh à sa production électrique annuelle, soit 60% de la production électrique française ou encore la production cumulée de 30 réacteurs nucléaires de type EPR !
Deja renommée pour sa technologie audacieuse, Pekin compte percer au moins quatre tunnels longs d’une vingtaine de kilomètres à travers la montagne et ainsi exploiter l’énergie potentielle d’un dénivelé – et donc l’équivalent d’une chute d’eau – haute de 2 km. Un exploit que Pekin venait déjà de réaliser dans la construction du tunnel autoroutier de haute altitude de Tianshan Shengli, long de 22 km.
Accroître son degré de compétitivité industrielle
Ce projet pharaonique s’inscrit dans la volonté de la Chine de consolider un avantage structurel majeur et d’accroitre son degré de compétitivité industrielle globale. En effet, une économie nécessite, pour être compétitive, de disposer d’une énergie bon marché, véritable carburant de base pour l’économie dans son ensemble.
Or l’énergie hydroélectrique, dont la Chine est aujourd’hui de très loin le premier producteur mondial – 425 GW de capacité installée, soit plus du quadruple de celle des USA – est indéniablement l’énergie la moins chère, avec un coût de revient au kw estimé à 2 centimes d’euros en France et la plus facilement exploitable en dépit des investissements colossaux qu’elle nécessite à la construction des infrastructures.
Des investissements qui ne sont pas à l’évidence à la portée de la bourse de plusieurs pays et qui font déjà dire, dans certains milieux, qu’il s’agit bien là d’une forme de « concurrence déloyale ».