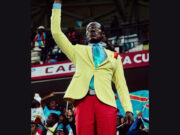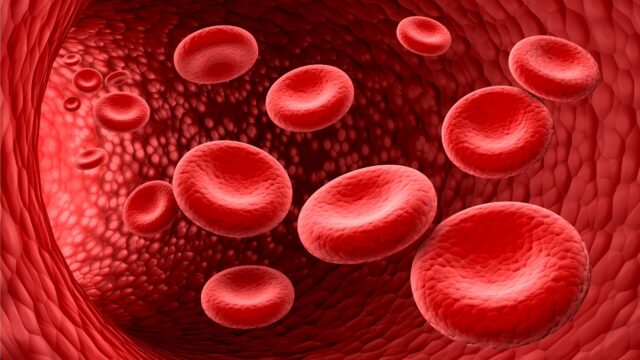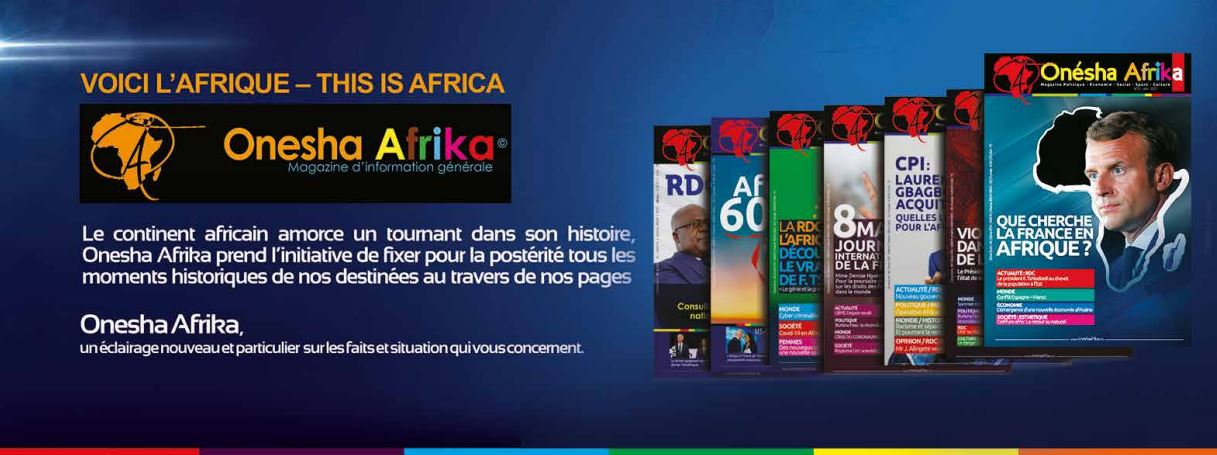Les scientifiques ont réussi à identifier un nouveau groupe sanguin après de longues recherches qui ont commencé en 1972. Ce groupe sanguin appelé MAL rejoint ainsi une liste déjà conséquente et sa découverte aidera à la prise en charge des patients possédant des groupes sanguins atypiques.
Quand on parle de « groupes sanguins », on pense spontanément aux groupes O, A, B ou AB. Ce sont en effet les plus connus. Pourtant, il en existe en réalité beaucoup plus ! Certains sont très rares, ce qui peut rendre difficile la prise en charge des patients les possédant.
Après 50 ans de mystères et de recherches, les scientifiques ont réussi à identifier un nouveau groupe sanguin, qu’ils ont dénommé MAL. Les résultats des recherches à ce sujet ont été publiés dans la revue Blood, selon le site Science et Vie.
Mais qu’est-ce qu’un groupe sanguin ? Il s’agit d’une classification des globules rouges, les fameuses cellules qui transportent l’oxygène dans le corps et qui entrent dans la composition du sang. Cette classification se fait selon la présence ou l’absence de certaines molécules, qu’on appelle antigènes, et qui peuvent être des protéines, des glucides ou encore des glycoprotéines, reconnues par nos anticorps et qui induisent une réponse du système immunitaire. D’où leur extrême importance en cas de perfusion.
Le groupe sanguin se détermine donc en fonction des antigènes portés par le globule rouge. Le groupe A aura des globules rouges avec un antigène A, le groupe B avec des antigènes B, le groupe O avec des antigènes O, etc… On regroupe ensuite ces différents groupes sanguins en système, les plus connus étant les systèmes ABO et Rhésus (Rh).
Des centaines de combinaisons
En réalité, il existe des centaines d’antigènes diffétents et donc autant de combinaisons. Certaines seront ainsi plus rares que d’autres. En Europe, on trouve principalement des individus avec une combinaison des systèmes ABO et Rh. On peut ainsi être du groupe O avec Rh + (plus couramment nommé O+) ; il s’agit des personnes dites « donneuses universelles ». Ces dernières peuvent ainsi donner leur sang à n’importe qui. À l’inverse, les personnes AB+ seront « receveuses universelles » et peuvent recevoir du sang de tous les groupes.
Connaître le groupe sanguin d’une personne est donc essentiel, surtout dans le cas d’une transfusion sanguine. En effet, tel qu’on l’a dit précédemment, les antigènes induisent une réponse immunitaire. Ces molécules sont essentielles à l’organisme pour différencier le « soi » du « non soi ».
Lorsque l’on se fait transfuser, on reçoit du sang venant d’une autre personne, du « non soi ». Les globules rouges que l’on reçoit risque donc d’être attaquées et détruites par notre système immunitaire. C’est ici qu’intervient la notion de compatibilité. Par exemple, les personnes O- ne peuvent recevoir que du sang O-, au risque de graves problèmes de santé si elles recevaient un autre type de globule rouge.
Plus de 380 groupes sanguins rares dans le monde

En dehors des plus connus, les systèmes ABO et Rh, dans les combinaisons les plus rares les scientifiques ont découvert plus de 380 dans le monde, et donc plus de 380 groupes sanguins rares. En France, ce sont les personnes originaires d’Afrique subsaharienne, des DROM ou de l’Océan Indien qui sont les plus susceptibles d’être porteuses d’un groupe sanguin considéré comme rare.
On parle de « rare » lorsqu’il concerne moins de 4 personnes sur 1000. C’est principalement la génétique qui est à l’origine des différentes combinaisons et donc des différents groupes sanguins. Parmi les « rares », on trouve notamment les groupes YT, MNS, Bombay, Lewis, Duffy ou encore Diego.
On découvre souvent ces groupes sanguins par hasard, lors d’un bilan avant une transfusion ou lors d’un suivi de grossesse. En outre, la rareté dépend principalement de la zone géographique où l’on vit. Ainsi, être Rh- en Chine est rare. Pourtant, cela correspond à 15% de la population en Europe. Encore aujourd’hui, des combinaisons rares sont découvertes. C’est notamment le cas de ce nouveau groupe sanguin, mis en évidence par des scientifiques du NHS Blood and Transplant (NHSBT) de South Gloucestershire. Une découverte qui aura pris près de 50 ans !
Un groupe lié à un antigène particulier : AnWj
Des recherches précédentes avaient pu montrer que 99% de la population mondiale portait l’antigène AnWj. Ce qui signifie, que 1% des personnes ne le possèdent pas. Chez elles, cette absence de AnWj peut être liée à une pathologie ou à la génétique.
Cette découverte d’un nouveau groupe sanguin s’est faite de manière fortuite. Et, surtout, elle a commencé en 1972. À ce moment-là, une femme enceinte se rendait à l’hôpital en urgence pour des problèmes avec son enfant à naître. Malheureusement, les médecins n’ont pas pu sauver l’enfant, dont les globules rouges étaient attaqués par le système immunitaire de la mère. En cause justement l’absence de cet antigène AnWj. À cette époque, on avait constaté que c’était principalement des pathologies qui supprimaient cet antigène chez les patients, comme des cancers ou des troubles hématologiques.
Cependant, dans le cas de cette femme enceinte et d’autres patients issus d’une même famille, on soupçonnait une cause génétique. Les scientifiques ont donc mené l’enquête. Grâce au séquençage des parties du génome qui codent pour les protéines, ils ont pu rechercher de potentielles mutations génétiques qui seraient responsables de l’absence de l’antigène AnWj.
L’analyse des échantillons a permis d’identifier des délétions particulières. Il s’agit de pertes de morceaux d’ADN et celles-ci avaient principalement lieu au sein du gène MAL. Ce dernier code pour une protéine présente sur les membranes des globules rouges.
Un nouveau groupe sanguin : le groupe MAL

Les individus AnWj négatif, privés de cet antigène de manière pathologique ou génétique, ne produisent donc pas la protéine MAL. Cette découverte a donc conduit les scientifiques à identifier et décrire un nouveau groupe sanguin : le groupe MAL.
C’est un nouveau pas en avant pour l’étude des groupes sanguins rares. En effet, si les patients AnWj- reçoivent du sang AnWj+ lors d’une transfusion, elles peuvent avoir une réaction immunitaire fatale. Ces résultats permettront ainsi de mettre au point des tests de génotypage pour identifier les personnes avec ce groupe sanguin.
« C’est une immense réussite et l’aboutissement d’un long travail d’équipe que de pouvoir enfin établir ce nouveau système de groupe sanguin et offrir les meilleurs soins à des patients rares, mais importants », explique Louise Tilley, auteure principale de l’étude.
Bénin : Découverte d’un nouveau traitement contre le diabète
Face à l’augmentation préoccupante du diabète en Afrique, une doctorante béninoise, Marie Marthe Chabi, explore une méthode innovante utilisant la lumière rouge et infrarouge pour stimuler les mitochondries du corps. Cette technique vise à améliorer l’absorption du glucose et à réduire l’inflammation, contribuant ainsi à la gestion du diabète de type 2, qui touche un nombre croissant d’Africains.
Le parcours de Chabi n’est pas sans défis. En phase d’expérimentation sur des animaux, elle met en avant le besoin crucial de financements pour progresser vers les essais cliniques. Bien qu’elle ait déjà accompli deux phases sur ressources limitées, la prochaine étape nécessite des investissements considérables en temps, matériel et finance.
La doctorante béninoise Marie Marthe Chabi fait partie de 30 jeunes talents scientifiques feminins de l’Afrique en 2024. Elle s’est distinguée par ses recherches novatrices sur le diabète de type 2, grâce auxquelles elle a été récompensée par le Prix Jeunes talents pour les Femmes et la Science en Afrique, délivré par la Fondation L’Oréal et l’Unesco.
Ce prix, qui est à sa 15ème édition, a reconnu 30 chercheuses africaines pour leurs contributions scientifiques.
Naviguer à travers les stéréotypes
En tant que femme scientifique en Afrique subsaharienne, Chabi doit également naviguer à travers les stéréotypes et le manque de reconnaissance souvent accordé aux femmes chercheuses.
Cependant, elle reste déterminée, espérant attirer l’attention et le soutien d’institutions intéressées par ses recherches.
Grâce à l’appui de la Fondation L’Oréal-Unesco, Marie Marthe Chabi se dit optimiste quant à obtenir les fonds nécessaires pour poursuivre ses travaux. Sa motivation personnelle, alimentée par ses expériences et défis, continue de l’inspirer à ouvrir de nouvelles voies dans le traitement du diabète.