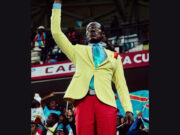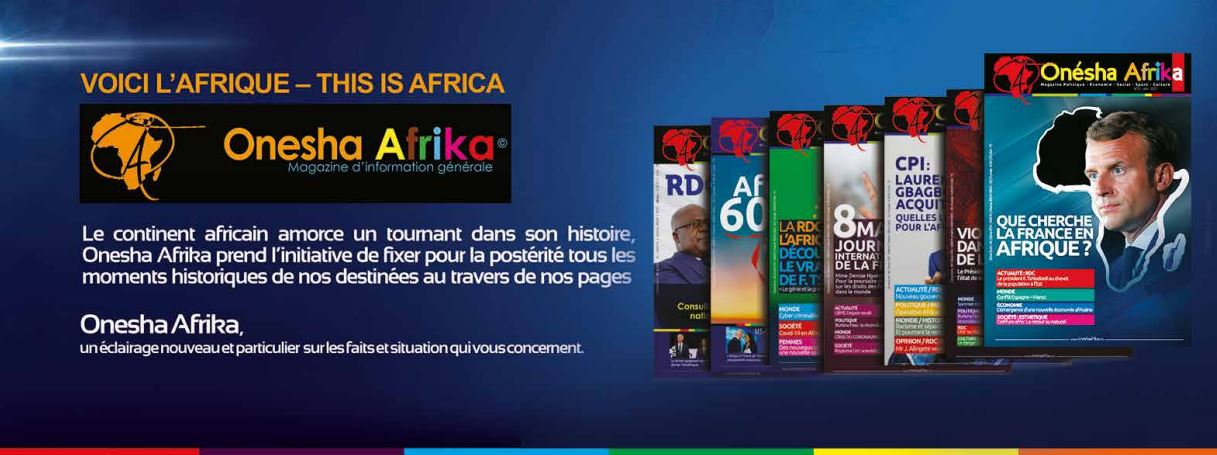«l’Alliance des États du Sahel»
Depuis la nuit des temps, la fascination pour les meneurs charismatiques, en fait les hommes de pouvoir, n’a jamais cessé. Qu’il soit politique, élu démocratiquement ou dictateur, militaire ou civil, « l’homme providentiel » est toujours attendu comme un sauveur dans des situations de crises économiques, militaires ou de révoltes sociales.
Les chamboulements géopolitiques de ces dernières années ont mis sur le devant de la scène de nouveaux hommes forts, particulièrement en Afrique.
La chute du mur de Berlin en 1989 et l’écroulement de l’Union soviétique en 1991 ont eu pour conséquence le déferlement d’une vague de démocratie et de liberté qui a submergé le monde. En Afrique, face à la pression internationale, nombre de Présidents-dictateurs ont dû organiser des Conférences nationales pour démontrer leur volonté de démocratiser leur régime, en y associant l’opposition.
Certains n’allaient jamais s’en remettre comme le Maréchal-président Mobutu qui, sous les assauts des troupes rwandaises et de la rébellion de l’AFDL (Alliance des Forces démocratiques pour la Libération du Congo) de Laurent-Désiré Kabila, était chassé du pouvoir en 1997.
Nombre de présidents ont perdu leur pouvoir après les Conférences nationales, mais leurs successeurs ne furent pas à la hauteur des espoirs placés en eux.
Entre les guerres du Congo-Zaïre, les événements politiques en Côte d’Ivoire et la chute du président Laurent Gbagbo en 2011, la guerre civile au Soudan et l’indépendance du Sud-Soudan en 2011, les révolutions tunisiennes et égyptiennes de 2010-2011, le début de la guerre au Mali en 2012, le début du 21ème siècle a été mouvementé pour l’Afrique.
Cependant, depuis février 2022, le monde entier a les yeux rivés sur la guerre en Ukraine, un conflit qui a dramatiquement changé la donne géopolitique mondiale.
Dans ce « grand jeu » qui a redéfini les alliances, le continent africain connaît un basculement historique. Les votes des pays africains lors des résolutions concernant la Russie à l’ONU, s’abstenant ou votant contre la condamnation de Moscou, ont démontré que le temps des zones d’influences politiques mises en place par la France et l’Europe après la seconde guerre mondiale est révolu.
Les soubresauts post-Conférences nationales et l’apparition des hommes forts
Dans cette nouvelle donne géopolitique, nombre de pays africains ont décidé de passer de ce qu’ils qualifient d’une indépendance formelle à une indépendance réelle. En un mot, se débarrasser concrètement du joug de l’ancien colonisateur. C’est-à-dire ne plus s’aligner sur sa politique étrangère, arrêter de voter par solidarité dans les instances internationales et rompre les accords de coopération militaire.
La nouvelle indépendance africaine n’est pas uniforme. Il est clair cependant qu’elle découle d’un nouveau panafricanisme en vogue sur le continent.
L’Afrique est aujourd’hui à la croisée des chemins. Elle est traversée depuis plus de 20 ans par une vague islamiste intégriste. Allant de l’Afrique de l’ouest, en passant par le Sahel, débordant sur la Corne et l’Est, plongeant au cœur de l’Afrique centrale et jusqu’à l’ Afrique australe où les djihadistes déstabilisent l’ensemble du continent.
Confrontée à un ordre géopolitique complètement chamboulé où plus aucune des règles héritées de la guerre froide n’a cours, au chaos du monde où les alliances sont devenues interchangeables et à des conflits à répétition pouvant déraper à tout moment, des nouveaux leaders sont apparus sur tous les continents.
Le culte de l’homme fort en Afrique est une tradition séculaire, de Shaka Zulu, au Maréchal-président Mobutu du Zaïre, la terre africaine regorge de leaders autoritaires. Aujourd’hui, dans les jeux d’influence du nouvel échiquier mondial, on peut identifier plusieurs hommes de pouvoir qui vont façonner le continent pour les années à venir. Tout d’abord, en Afrique de l’ouest et au Sahel à la fin des années 2010, l’instabilité de l’ensemble de la région va crescendo et ce malgré l’intervention des troupes françaises via les dispositifs de Serval et de Barkhane.
En effet, celles-ci reprennent en 2013 les villes du Nord du Mali, Gao, Tombouctou et Kidal aux groupes djihadistes. Cependant, la stratégie de la tension des groupes islamistes qui continuent leurs assauts, couplée à la fatigue des populations et des militaires face à des présidents qui préfèrent passer leur temps dans les palais de Dubaï ou de France, commencent à peser.
Succession de putschs
De 2020 à 2023, quatre États sont secoués par des putschs. Tout d’abord le Mali avec le renversement du président Ibrahim Boubacar Keita, suivi d’un deuxième coup d’État en mai 2021 au cours duquel le colonel Assimi Goita s’empare du pouvoir et devient président intérimaire jusqu’à ce jour, avec grade de général. Ensuite la Guinée-Conakry avec le coup d’État du 5 septembre 2021, quand le général Mamadi Doumbouya s’empare du pouvoir en démettant le président Alpha Condé, avant de passer du statut de président de transition à celui de président de la République. Puis le Burkina Faso, avec un premier coup d’État en janvier 2022 qui conduit à l’arrestation du president Roch Kaboré et la mise en place d’un gouvernement de transition, suivi d’un second en septembre 2022 portant au pouvoir le colonel Ibrahim Traore.
Finalement, le 26 juillet 2023, le président du Niger, Mohamed Bazoum, est déposé par un de ses fidèles, le général Abdourahamane Tchiani, qui demeure jusqu’ à ce jour président intérimaire.
Si le général Doumbouya à la tête de la Guinée Conakry n’a pas lié son destin aux trois autres États, qui ont créé un pacte de défense mutuelle, l’Alliance des États du Sahel, il est évident que ces pays et leurs populations en grande partie, même si ces derniers temps, en Guinée Conakry ou au Niger, il y a eu des manifestations, ont décidé de vivre pleinement leur nouvelle indépendance.
Les populations africaines déçues par des expériences démocratiques qui n’ont pas amélioré leurs conditions de vie tant au niveau sécuritaire que social ou alimentaire et dégoutées par des élites corrompues pérennisant un pseudo- système démocratique qui n’en a que le nom, considèrent dès lors les putschs comme une bénédiction.
L’Alliance du Sahel, Joao Lourenço et Félix Tshisekedi

Les quatre hommes forts du Sahel ont rompu leurs relations de coopération militaire ou pris leur distance avec la France, réinventé leur politique étrangère, forgé de nouvelles alliances à divers degrés avec la Russie, car cette dernière ne conditionne pas les relations aux valeurs occidentales, et se positionnent comme des nouveaux guides pour le panafricanisme.
D’autres hommes providentiels, avec plus d’expérience, s’imposent, à l’instar du président angolais Joao Lourenço. Succédant à Dos Santos en 2017 comme président puis comme président du MPLA en 2018, il remporte l’élection présidentielle d’août 2022, conforté comme seul maître à bord.
À deux niveaux il prend sa dimension d’homme fort. Tout d’abord en se positionnant comme le médiateur et négociateur clé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda via le processus de Luanda pour lequel logiquement au mois de novembre un accord doit être signé par les deux pays ; ensuite par l’accord sur le Corridor de Lobito, un atout économique et stratégique qui doit permettre à la RDC, à la Zambie et à l’Angola de booster leur économie en réduisant les coûts et le délai de transport. Tout en permettant d’accroitre la valeur ajoutée agricole, énergétique et logistique. Aujourd’hui Lourenço incarne la nouvelle génération des leaders africains qui s’impose sur la scène mondiale.
Un autre, le président de la RDC Félix Tshisekedi, malgré les critiques dont il fait l’objet de la presse belge et européenne, émerge également comme un des nouveaux hommes forts du continent. Plombé par son prédécesseur Joseph Kabila pendant la moitié de son premier mandat de 2019 à 2023, il a réussi à réunir une large coalition pour faire avancer une série de réformes économiques et sociales. Réélu pour un second mandat qui conforte sa légitimité, il fait face ainsi que le Congo à une agression dirigée et commanditée par le Rwanda sous le « False Flag » du M-23 et de l’alliance du Fleuve Congo (AFC).
Confronté à des voisins régionaux qui voit l’Est du Congo comme un terrain qu’ils peuvent piller, il tente de réunir des soutiens internationaux afin de les faire condamner et les mettre sous sanctions. La diplomatie plutôt que la guerre totale, tel est le choix du président congolais et c’est tout à son honneur. Mais les voisins du Congo doivent comprendre que la volonté de paix n’est pas un aveu de faiblesse. Le président Félix Tshisekedi, en digne héritier politique du Maréchal président Mobutu sait que l’intégrité du territoire national congolais n’est pas négociable. Le Congo est un poids lourd régional et international de par ses ressources, sa taille et son Histoire.
La suite dans notre prochaine édition
*Max Olivier Cahen est ancien conseiller du Maréchal Mobutu et auteur d’un mémoire intitulée « Stratégie d’expansion et d’hégémonie de l’intégrisme islamique en Afrique subsaharienne »