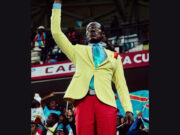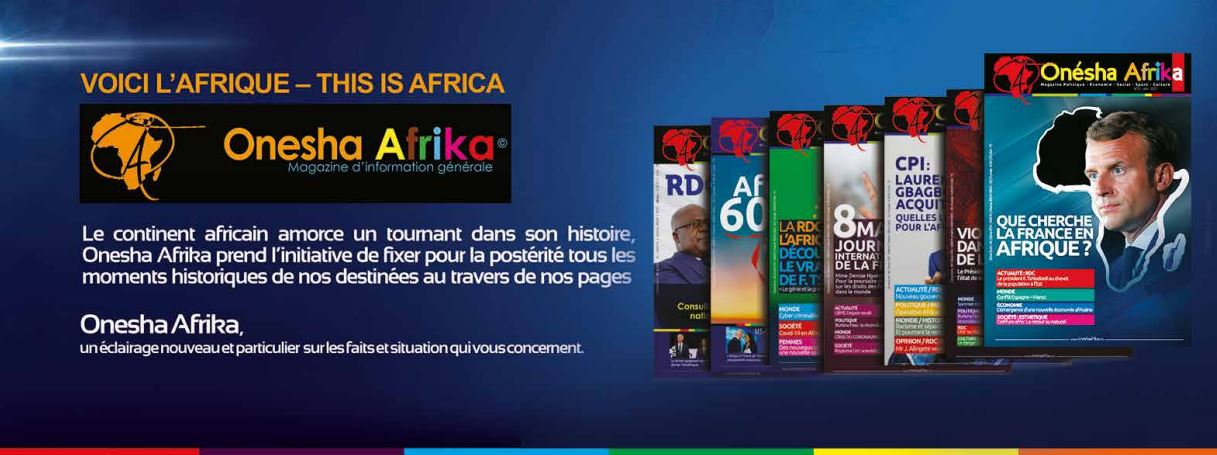Politiques de grands travaux, dépenses publiques accrues par des prix de produits encadrés. Dans un contexte de besoins de fonds en augmentation des pays d’Afrique centrale, il est devenu essentiel pour la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (Cémac) de lever des capitaux sur le marché régional des titres publics.
Les grands argentiers de la région se sont réunis à Brazzaville début septembre. À cette occasion, des chiffres ont été révélés et un nouveau record a été battu : les États de la Cémac ont levé plus de 7 000 milliards de francs CFA sur le marché régional, soit près de 11 milliards d’euros de dettes en cours.
« Une capacité d’emprunt considérée comme une performance, comparée aux premières levées de fonds réalisées à la création du marché en 2011 », souligne le communiqué du ministère congolais de l’Économie et des Finances. Seulement ces cinq derniers mois, près d’un million d’euros ont été empruntés sur ce marché, un niveau de dettes révélateur de la demande des États. Un montant utilisé notamment pour financer leurs besoins en trésorerie.
Cependant, les objectifs d’emprunts ne sont pas toujours atteints, car aujourd’hui les banques commerciales atteignent leurs niveaux de prêt maximum, souligne le média spécialisé, Sika Finance. Ces banques sont les principaux créanciers de la Cémac.
Appel à l’investissement des privés
Pour rester dans les règles de prudence imposées, la marge de manœuvre des établissements bancaires est désormais très limitée. La solution pour les États de la Cémac réside dorénavant dans l’investissement des acteurs privés qui restent, pour l’instant, frileux à prêter.
Autre inquiétude, souligne l’analyste Cédrick Jiongo, celle de la capacité des États à honorer leurs dettes. Pour la première fois depuis la création du marché régional des titres publics, un État n’a pas été en mesure de régler une échéance.
Or, le marché des titres publics a besoin que les créanciers restent confiants en leurs débiteurs pour continuer à prêter.
Pour répondre à cette problématique, une charte de bonne conduite devrait être adoptée par les États, lors de la prochaine réunion prévue en décembre 2024.
Un bilan mitigé pour les 30 ans
La Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale a fêté ses 30 ans. Pour célébrer l’évènement, une cérémonie était organisée le 16 mars dernier à Bangui, la capitale centrafricaine.
Faustin-Archange Touadéra, président de la RCA, mais aussi président de la Conférence des chefs d’État de la Cemac y a prononcé un discours pour évoquer le bilan de l’intégration régionale, un bilan très mitigé.
C’était il y a trente ans à N’Djamena, au Tchad, six pays d’Afrique centrale (Cameroun, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale et Tchad) fondaient la Cemac pour accroitre les échanges et harmoniser les règles douanières.
Depuis, force est de constater que la Cemac fait face à de nombreuses difficultés. Certains parlent de l’organisation comme d’une union purement administrative. Si des mesures sont prises pour assurer la libre-circulation des biens et des personnes, comme la mise en place d’un passeport communautaire en 2017, dans les faits les choses sont plus compliquées.
La limitation des pouvoirs des institutions sous-régionales rend difficile l’application des décisions, un phénomène amplifié par le manque d’infrastructures routières et électriques, notamment, qui empêchent de relier correctement les pays entre eux.
À peine 4% d’échanges entre les pays membres
Résultat, la Cemac est l’un des blocs économiques les moins intégrés du continent. Ses membres commercent, à 80%, avec l’extérieur comme la Chine, la Russie ou encore l’Europe, mais seulement à 4% entre eux. L’intégration régionale, pourtant inscrite dans les textes de l’organisation, est donc encore lointaine.
Parmi les prochains chantiers qui attendent la CEMAC, le plus important est sans doute celui des treize projets intégrateurs qui incluent des routes, ponts ou encore des infrastructures électriques. Ils doivent permettre de mieux connecter les pays membres entre eux. En novembre dernier à Paris, les responsables de l’organisation annonçaient avoir levé plus de 9 milliards d’euros pour les mettre en œuvre.