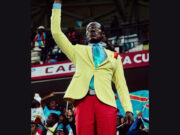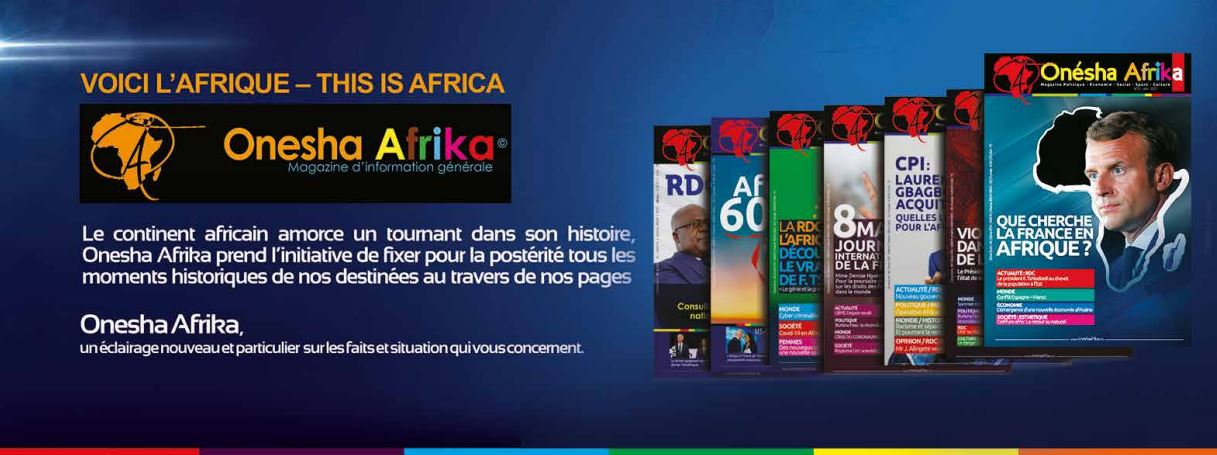Depuis la chute de Mouammar Kadhafi et son assassinat le 20 octobre 2011, la Libye est devenue le terrain de jeux de politiciens véreux, de multiples milices armées et de grandes puissances. Celles-ci qu’elles, soient régionales ou internationales, ont fait de la Libye un terrain de rivalités géopolitiques où elles s’affrontent par procuration. Cette globalisation du conflit est devenue le principal obstacle à sa résolution.
Lorsque les premiers signes du « Printemps arabe » apparaissent dans différents pays du Maghreb, les observateurs et les experts pensent tout d’abord à de simples manifestations contre le coût de la vie. Cependant le 17 décembre 2010, tout s’enflamme avec le déclenchement à Sidi Bouzid de la révolution en Tunisie conduisant au renversement de Ben Ali le 14 janvier 2011.
À ce moment-là, c’est une véritable traînée de poudre qui se propage. Pas un seul pays n’est épargné d’une manière ou d’une autre. On assiste à des émeutes et des manifestations où les peuples reprennent à leur tour le slogan « Dégage ! » devenu le symbole de ces révolutions. Les conséquences de cette volonté de changement des peuples provoquent des bouleversements dans le monde arabe.
En Égypte, renversement du président Moubarak, guerre civile en Syrie, changement de gouvernement en Jordanie, au Maroc des réformes politiques et sociales sont réclamées. Le 9 mars, le roi Mohammed VI annonce une importante réforme constitutionnelle, soumise à référendum, visant à renforcer les pouvoirs du Premier ministre et des partis politiques. Même les dynasties pétrolières du Golfe sont secouées, le Bahreïn particulièrement qui voit intervenir une force militaire conjointe de l’Arabie saoudite et des Émirats Arabes unis pour stabiliser la situation. Le Yémen quant à lui est gagné par la violence malgré le changement de président et sombre dans la guerre civile en 2014.
La Libye et le Yémen ne se remettront jamais des Printemps arabes
Si les printemps arabes ont été porteurs d’espoir, l’ordre a vite été rétabli ! Les militaires reprennent le pouvoir en Égypte par le coup d’État du Maréchal Sissi en 2013, en Tunisie le président Kaïs Saïed, élu en Octobre 2019 et réélu en 2024, dirige le pays d’une main de fer qui n’a rien à envier à la dictature de Ben Ali. En Syrie, la guerre civile a fini, malgré le soutien de Moscou, par rayer la dynastie des Assad en 2024, alors que deux états ou plutôt deux non-états, la Libye et le Yémen, ne se sont jamais remis des Printemps arabes.
Lorsqu’en février 2011, une insurrection populaire éclate en Libye, elle commence d’abord à Benghazi le 15 février pour s’étendre à tout l’est de la Jamahiriya arabe libyenne. Le 21 février, la contestation gagne tout le pays, dont Tripoli dès le 23 février. L’entièreté de l’Est passe sous le contrôle des insurgés ainsi que plusieurs villes de l’ouest. Dans la foulée, un Conseil national de Transition est créé le 27 février.
Cependant, à partir du 6 mars les forces de Kadhafi reprennent l’avantage, déclenchant ainsi le 18 mars le vote d’une zone d’exclusion aérienne au Conseil de sécurité de l’ONU. Lancé à l’initiative de Nicolas Sarkozy, trop heureux de se débarrasser de son encombrant ami pourvoyeur de fonds, le président français de l’époque convainc, avec le Premier ministre britannique David Cameron, le président Obama du bien-fondé de cette action.
La France, les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni commencent alors leurs frappes peu après l’attaque de Benghazi, capitale du CNT. En octobre 2011, Kadhafi est capturé et tué par les insurgés près de Syrte, sa ville natale. Tout le monde parle d’une nouvelle ère de liberté pour la Libye, d’une vraie démocratie et d’un nouvel élan.
Plus dure sera la chute

L’enthousiasme occidental retombe très vite, la chute du régime n’apporte aucune stabilité. Au contraire, elle ouvre la voie à un vide institutionnel que les nouvelles autorités sont incapables de combler. À partir de 2014, le pays plonge dans une guerre civile opposant deux gouvernements rivaux : le gouvernement d’accord national (GAN), établi à Tripoli, soutenu par les islamistes et reconnu par la communauté internationale, et le gouvernement de Tobrouk, appuyé par le maréchal Khalifa Haftar et son Armée nationale libyenne (ANL). Face à cette situation de guerre civile, nombre d’émissaires internationaux, mandatés par des États ou l’ONU, tentent de trouver un terrain d’entente entre les différentes factions.
Finalement les accords de Skhirat sont signés le 17 décembre 2015 au Maroc. Ceux-ci constituent réellement un accord politique majeur visant à mettre fin au morcellement du pays et au conflit en général. Conclus entre les représentants du Congrès général national (Tripoli) et de la Chambre des représentants (Tobrouk) sous l’égide de l’ONU, ces accords mettent en place un gouvernement d’union nationale (GUN) dirigé par Fayez el-Sarraj, ainsi que l’installation d’un Conseil présidentiel et d’un Haut Conseil d’État pour unifier l’ensemble des institutions libyennes.
L’Accord de Skhirat est reconnu internationalement comme le seul cadre politique légal et légitime pour résoudre la crise libyenne. Il reçoit tant le soutien du Conseil de sécurité de l’ONU que des principales puissances occidentales et apparaît comme la seule référence pour les négociations politiques à venir et les efforts de stabilisation du pays.
Mais le cadre ne fonctionne pas et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nombre d’acteurs politiques et groupes armés n’ont pas été associés à l’élaboration de l’accord ou carrément le refusent. C’est le cas du Maréchal Haftar, qui déclare que l’accord est caduc et, de plus, entièrement favorable aux islamistes.
Ensuite ce gouvernement d’union nationale n’a aucune légitimité, sa constitution s’est faite sans le vote de confiance de la Chambre des représentants issue des élections de 2014 et le Premier ministre Fayez el-Sarraj qui reste étroitement lié aux milices, sa base et son autorité politique s’en trouvent largement réduites.
L’échec de l’Accord de Skhirat
Autre point essentiel que l’accord n’a pas abordé, celui des groupes armés, tous remarquablement équipés et bénéficiant de moyens financiers conséquents, contrôlant les territoires et infrastructures les plus stratégiques, notamment à Tripoli. Cet oubli volontaire ou non, a empêché la réunification des forces militaires et donc la restauration de l’État de droit. Dernière faiblesse, la création du Haut Conseil d’État, totalement sous influence de la mouvance des Frères musulmans et qui, de facto, crée une sorte de « deuxième chambre » parlementaire accentuant nombre de divisions
En un mot, les accords de Skhirat sont un échec non seulement pour ne pas avoir intégré toutes les données de la problématique libyenne mais pour avoir « oublié » d’inclure des acteurs essentiels du conflit libyen.
Dès 2017, les deux camps se livrent à de violents combats pour contrôler l’ensemble du territoire. L’armée du maréchal Haftar progresse, s’emparant coup sur coup de Derna, le bastion des Islamistes intégristes, puis de Sebha, ville emblématique du Sud désertique, et surtout Al-Charara, un des plus grands champs pétroliers. Le conflit s’internationalise graduellement, puissances régionales et internationales jouant les parrains des protagonistes.
En avril 2019, les forces du Maréchal Haftar appuyés par les Russes de Wagner, les Émiratis et les Égyptiens lancent une offensive générale contre Tripoli. De leur côté en 2020, l’armée du GNA soutenues par la Turquie s’emparent de tout l’Ouest du pays. La confrontation militaire virant à une partie de bras de fer, caractérisée par des reconquêtes de certains territoires et la perte d’autres par les deux forces en présence, des négociations sont alors lancées, aboutissant finalement à un cessez-le-feu signé en octobre 2020 à Genève.
En ce moment-là, une transition est mise en place avec le soutien et la surveillance de l’ONU et en mars 2021 un gouvernement d’Union nationale est formé sous la houlette de Abdel Hamid Dbeibah qui devient Premier ministre. Dans ce contexte supposé de transition pacifique, l’élection présidentielle qui devait intervenir en décembre 2021 est reportée de manière permanente, quelques jours avant la date prévue.
Face à ces reports, le parlement de Tobrouk élit Fathi Bachagha avec le plein soutien du maréchal Haftar. Cette élection est considérée illégitime par Dbeibah qui, soutenu par l’ONU, refuse de céder face à un gouvernement non élu par les urnes. La Libye se retrouve à nouveau divisée entre deux gouvernements rivaux comme en 2014 et en 2020.
Max Olivier Cahen est un ancien conseiller du Maréchal Mobutu et auteur d’un mémoire intitulé « Stratégie d’expansion et d’hégémonie de l’intégrisme islamique en Afrique subsaharienne »