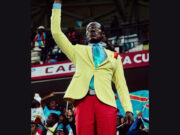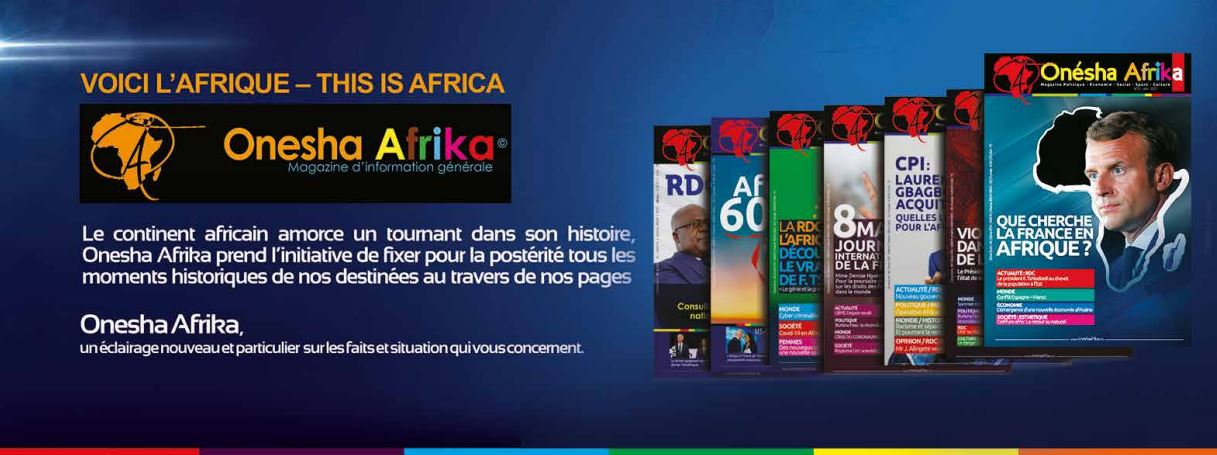En Afrique du Sud, les maris devraient désormais pouvoir choisir de prendre le nom de famille de leur épouse. La Cour constitutionnelle a tranché. Dans un arrêt rendu le jeudi 11 septembre, elle a jugé discriminatoire la loi qui l’interdisait jusqu’à présent.
En Afrique du Sud, deux couples sont à l’origine de cet arrêt. Les maris s’étaient vus refuser le droit de porter le nom de famille de leur épouse. Dans le premier cas, le mari souhaitait porter le nom de sa future épouse pour honorer la mémoire des parents de celle-ci, aujourd’hui décédés. Dans le second, l’épouse étant fille unique, cette dernière voulait pouvoir conserver son lien avec le nom de sa famille.
Les deux couples ont mis en avant une violation du principe d’égalité garantie par la Constitution sud-africaine, adoptée à la fin de l’apartheid. Aussi, ils ont donc décidé de porter l’affaire devant les tribunaux.
Dans son arrêt rendu, la Cour constitutionnelle sud-africaine leur a donné raison. Elle a estimé que la loi en vigueur était un héritage colonial et renforçait les normes patriarcales. Avant cet arrêt, les hommes devaient s’adresser au ministère de l’Intérieur afin de demander l’autorisation de changer leur nom de famille. Pire, cette demande n’était pas systématiquement acceptée.
La société civile lutte collectivement contre la dégradation de Johannesburg

En Afrique du Sud, la dégradation généralisée de Johannesburg inquiète les habitants. Fatigués des manquements de la municipalité – qui a changé neuf fois de maire, depuis 2021 – ils s’organisent de plus en plus à travers des organisations de société civile en vue de tenter de redonner de l’éclat à leur municipalité.
La société civile s’organise non seulement pour faire pression sur les instances dirigeantes, mais aussi pour trouver des solutions. Une centaine d’organisations se sont ainsi réunies, le samedi 30 août, pour le 7ème sommet du Jobourg Crisis Alliance, un mouvement civique rassemblant ces organisations pour lutter collectivement contre le déclin de Johannesburg.
C’est en bordure du centre-ville de Johannesburg, l’une des parties de la métropole les plus touchées par la déliquescence, que se retrouvent quelque 200 citoyens. La crise de l’eau est au cœur de leurs préoccupations.
L’espoir de reformes
« Nos infrastructures sont vétustes et défaillantes. Nos canalisations fuient. Nos réservoirs ne fonctionnent pas correctement. Des écoles doivent parfois fermer et les gens rentrent chez eux parce qu’il n’y a pas d’eau. Il ne s’agit plus seulement d’un service public, mais de répondre à une crise humanitaire », tient à souligner Ferrial Adam, directrice exécutive de l’initiative « WaterCAN » qui lutte pour l’accès à l’eau et pour une amélioration de la qualité de l’eau.
Les résidents sont de plus en plus régulièrement privés d’eau, mais aussi d’électricité ou encore de collecte des déchets. Ils dénoncent la négligence des autorités qui ont laissé les infrastructures se dégrader dramatiquement.
« Le problème fondamental, c’est la mauvaise gestion financière de la ville. Malgré son budget colossal de 4,4 milliards d’euros par an, elle ne fournit pas les services de base que ses habitants méritent. Notre travail consiste essentiellement à réclamer des comptes, à maintenir la pression et à continuer de soulever les problèmes que la ville refuse de dresser », dénonce Yunus Chamda, coordinateur du Joburg Crisis Alliance.
De plus en plus d’initiatives de quartier voient le jour, d’habitants désireux de ne pas rester passifs. Les activistes se réjouissent aussi du comité de travail mis en place en mars par la présidence, pour redresser la capitale économique du pays. Ils espèrent enfin des réformes.