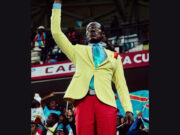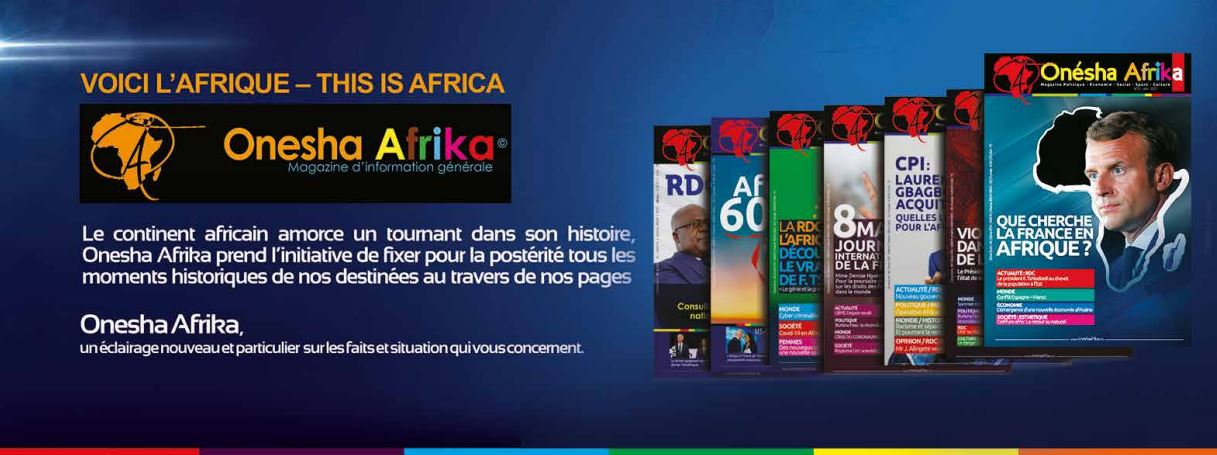Déforestation, urbanisation et agriculture intensive « menacent les composantes du système terrestre et la survie de l’humanité », alerte l’Institut de recherche de Potsdam sur les effets du changement climatique (PIK). Son rapport spécial avait été dévoilé en ouverture de la COP16 Désertification à Riyad, en Arabie saoudite. Le plus gros chapitre est consacré aux solutions concrètes, anciennes ou plus modernes, à cette crise. Le modèle agricole conventionnel est appelé à une transformation en profondeur.
Les termes sont alarmants, pour ne pas dire sentencieux : « La dégradation des terres compromet la capacité de la Terre à supporter l’humanité », « les preuves scientifiques sont sans ambiguïté : la façon dont nous allons gérer nos terres déterminera directement le futur de la vie sur Terre ». « Transformer l’usage des sols » devient donc « critique ».
Les chiffres ne le sont pas moins, même s’ils sont « contradictoires », admet le rapport, qui s’en explique par les « différences dans les indicateurs et les définitions ». Celui-ci retient le chiffre de la Convention de l’ONU sur la désertification (CNULCD) : « 15 millions de km² de terres dégradées », une superficie voisine de celle de la Russie, avec un million de km² supplémentaires perdus chaque année. Sauf que l’ONU dit qu’il faudrait « restaurer 15 millions de km² d’ici 2030 pour parvenir à un monde neutre en matière de dégradation des terres », ce qui n’est pas la même chose. L’Organisation estime à 40% la proportion des terres émergées affectées. Soit 60 millions de km².
Les terres sont « les fondations de la stabilité de la planète. Elles régulent le climat, préservent la biodiversité, maintiennent les systèmes d’eau douce et fournissent des ressources vitales telles que la nourriture, l’eau et les matières premières », rappelait le communiqué de presse diffusé en amont du rapport de 120 pages.
Le réveil est déclenché par les chercheurs du PIK, centre scientifique public allemand auquel s’est associée à cette occasion la Convention Désertification de l’ONU (équivalente de celles du climat et de la biodiversité), à la veille de l’ouverture de la COP16 qu’elle encadrait. À l’instar des rapports du Giec pour le climat, ce rapport spécial publié se veut « un état des lieux de la recherche sur la dégradation mondiale des terres ». L’équipe de dix-neuf chercheurs est dirigée par le Suédois Johan Rockström, géniteur en 2009 du concept évolutif des « limites planétaires », et directeur du PIK.
Au nombre de neuf, ces limites désignent les grands processus biophysiques terrestres qui conditionnent le bien-être des humains, des seuils à ne pas franchir au risque d’effets d’emballement des équilibres naturels. En septembre 2023, six étaient considérées comme dépassées et deux autres (l’acidification des océans et la concentration d’aérosols dans l’atmosphère) s’approchaient du seuil.
Sur les neuf limites planétaires théorisées par le PIK, sept sont déjà dépassées. La septième, l’acidification des océans, encore en vert en 2023, est désormais considérée comme franchie, selon le rapport 2025 du PIK. Une fois franchie, la bascule irréversible peut intervenir plus ou moins rapidement, mais un retour vers un espace de vie sûr est possible si l’humanité menacée s’en donne les moyens.
En dix ans, -20% de capacité de stockage de CO2 dans les arbres et les sols
Pour examiner la dégradation des terres et les possibilités d’action dans la perspective des limites de la planète, cette synthèse s’est appuyée sur quelque 350 références scientifiques. Le changement de l’usage des terres (principalement la déforestation pour y mettre de l’agriculture intensive ou étendre des villes), qui est lui-même l’une de ces limites, est au cœur du problème parce qu’il en repousse sept autres, affirme le rapport de Rockström : le changement climatique, l’érosion de la biodiversité, les écosystèmes d’eaux douces, la perturbation des cycles biogéochimiques de l’azote et du phosphore, l’introduction de nouvelles entités (pollution et produits toxiques), l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère et donc le changement de l’usage des sols. « On se tient au bord du précipice et nous devons choisir entre reculer et prendre des actions transformatrices ou poursuivre sur la voie d’un changement environnemental », a commenté Johan Rockström.
Le rapport précise toutefois que « mesurer les interactions entre les limites reste un défi », car s’entrecroisent des liens de causes à effets physiques et d’origine humaine qui s’alimentent. Par exemple, des changements environnementaux engendrent parfois l’adaptation des populations. La conversion des terres (déraciner des arbres au profit de cultures) contribue au changement climatique, mais le changement climatique contribue également à la dégradation des terres, qui à son tour nécessitera la conversion de nouvelles terres pour la production végétale, aux dépens de puits de carbone, aggravant le climat, etc. Les sécheresses, plus fréquentes et plus sévères, sont un facteur majeur de dégradation des terres. « Les liens entre le changement de l’usage des terres avec les autres limites sont dominés par l’interaction terres-climat, notamment à travers la perte en capacité de stockage de carbone », écrivent les auteurs, pointant un « cercle vicieux d’effets négatifs. »
Citant le rapport Global Carbon Budget (2023), le rapport rappelle que la capacité de stockage des continents, de 3,7 milliards de tonnes de CO2 par an, stabilise le système climatique. « Sur la décennie, la déforestation et le changement climatique ont réduit de 20% la capacité de stockage de CO2 des arbres et des sols. Le couvert forestier mondial a été réduit à 60% de sa superficie originelle, alors que la limite fixée par le cadre des limites planétaires est de 75% », soulignent les experts. Or, « échouer à inverser le changement de l’usage des systèmes fonciers pourrait, régionalement ou même mondialement, compromettre la capacité des forêts à se maintenir, à grandir et potentiellement à transformer un puits net en source nette d’émissions ».
Dans la même logique, la biodiversité pâtit du changement de l’usage des terres car celui-ci perturbe, déplace, détruit des habitats et des routes migratoires, « remplacés par des paysages conçus pour l’usage humain ». « Depuis 1970, il a été le premier facteur de la perte de biodiversité et des écosystèmes d’eau douce, l’expansion des terres agricoles étant la forme la plus répandue de changement de l’usage des sols ».
L’agriculture conventionnelle étrillée

Mise au pilori, « l’agriculture conventionnelle » est désignée, au côté des sécheresses, comme « le principal responsable de la dégradation des sols » car elle « contribue à la déforestation, à l’érosion des sols et à la pollution ». « Les pratiques d’irrigation non durables épuisent les ressources en eau douce, tandis que l’utilisation excessive d’engrais à base d’azote et de phosphore déstabilise les écosystèmes ».
Les régions sèches du sud-est asiatique, du nord de la Chine, des grandes plaines américaines, de la Californie et du bassin méditerranéen sont particulièrement exposées, et les pays pauvres et tropicaux sont encore plus à risques. Cette pratique agricole relâche 23% des émissions de gaz à effets de serre (GES), cause 80% de la déforestation et compte pour 70% de l’exploitation des ressources d’eau douce. Dans les pays à bas revenus, la moitié des émissions agricoles de GES provient de la conversion des forêts, et seulement 6% dans les pays riches.
Participent de cette dégradation « à une échelle inégalée » de nombreuses autres constantes socio-économiques : corruption, inégalités hommes-femmes ou encore urbanisation. Cette dernière, tout en présentant des avantages, est catastrophique pour les populations et l’environnement « lorsqu’elle est incontrôlée ». À Joao Pessoa (Brésil), sur les littoraux de Roumanie, du Vietnam, d’Algérie et d’Italie victimes de la pression touristique, l’étalement urbain « affecte particulièrement les limites planétaires ». Le rapport relève cependant différentes « initiatives prometteuses » pour améliorer la durabilité des villes (Kigali, Depok City en Indonésie).
Le document insiste enfin sur la fondamentale nécessité « de justice et d’équité » et mentionne les critiques qui ont été adressées au cadre de pensée des limites planétaires qui « ignore la dimension humaine ». Or, « sans prendre en compte les contextes socio-économiques dans lesquels une dégradation environnementale survient, les solutions peuvent être techniquement solides mais manquer d’être utiles ou équitables ».
« Si nous ne reconnaissons pas le rôle central des terres et ne prenons pas les mesures appropriées, les conséquences se répercuteront sur tous les aspects de la vie et se prolongeront dans le futur, intensifiant les difficultés pour les générations futures », a commenté le secrétaire exécutif de la Convention de l’ONU sur la désertification, Ibrahim Thiaw. Dans une conférence de presse, le Mauritanien égrenait déjà les conséquences concrètes des sécheresses et de la dégradation des sols sur la sécurité humaine (les conflits pour des terres fertiles et pour l’eau douce), alimentaire et énergétique (nucléaire, hydroélectricité), le fret maritime (canaux de Panama et Suez), sur la santé avec la diffusion de maladies d’origine zoonotiques animales et sur le départ forcé de populations. « Riche ou pauvre, aucun pays n’est épargné », a-t-il averti.
Réforme de l’agriculture, restauration des sols et forêts et robots : les solutions ne manquent pas
Mais ce « rapport spécial sur les terres », intitulé « reculer du précipice : transformer la gestion des terres pour rester dans les limites de la planète », consacre aussi le plus long des quatre chapitres aux pistes à privilégier pour corriger cette tendance peu souhaitable. « La préservation des sols est cruciale pour la sécurité alimentaire et pour tous les autres services écosystémiques et requiert une transition vers une agriculture et un système alimentaire durables qui équilibrent augmentation de la productivité et diminution des impacts environnementaux ».
Parmi les grandes mesures « cruciales pour stopper et inverser » ce processus de délabrement, la « réforme de l’agriculture » est en tête de file, au profit de « l’agroécologie » et de l’« agriculture régénératrice » (conservation des sols, permaculture…). Les techniques propres à ces pratiques durables (couverture permanente des sols, rotation des cultures, non-labour, etc.) renforcent la santé des sols face aux aléas climatiques, accroissent les niveaux de rendements et favorisent le stockage de carbone. Les cultures en terrasse, comme en Éthiopie ou au Rwanda, « sont hautement efficientes », précise le rapport. Ceci pour combattre l’érosion et ralentir le débit de l’écoulement des pluies, tout comme les cultures en courbes de niveaux, pratiquées au Zimbabwe. La technique de l’agroforesterie offre pour sa part une kyrielle de bénéfices, mais n’est pas forcément adaptée dans les régions tropicales semi-arides où elle peut « exacerber la compétition pour l’eau » et malmener la productivité.
Parmi les autres grands axes de progrès : une gestion des ressources aquifères, des chaînes d’approvisionnement durables, une gouvernance des terres équitable et la protection des forêts, des savanes, des tourbières et des prairies, puits de carbone indispensables.
Enfin, le rapport s’attarde sur plusieurs technologies agricoles numériques utiles : drones, robots, intelligence artificielle entre autres servent « l’agriculture 4.0 » de précision (en eau, en produits de synthèse), tout en « surveillant les changements du foncier en temps réel » ainsi que la détection plus précoce de ravageurs de cultures. La cartographie aérienne de la sévérité, de l’étendue et du type de dégradation des terres est aussi utile pour prendre des mesures de réhabilitation.
Enfin, l’étude promeut deux technologies éprouvées depuis quelques années. L’une, onéreuse, consiste à recourir à des robots-solaires, équipés de GPS et de capteurs sensibles pour planter des graines et gérer les cultures sans recours aux herbicides. Plus délicats que les machines conventionnelles, ils épargnent les plantes et les sols. « Dans des conditions optimales, un seul robot peut traiter plusieurs hectares par jour », insiste le rapport qui renvoie vers une étude de 2024.
Moins coûteuse, l’application Plantix, gratuite et désormais disponible dans 18 langues, utilise l’IA pour détecter au moins 680 maladies et ravageurs de 80 cultures mais aussi identifier d’éventuels manques nutritionnels du sol. Dans le premier cas, cela permet de réduire l’utilisation de pesticide et dans le deuxième d’ajuster les besoins en fertilisants. L’application est utilisée « avec succès » au Brésil et en Inde où « neuf millions de photos géo-localisées de plantes malades ont été prises en deux ans ».