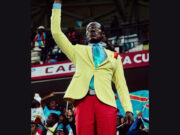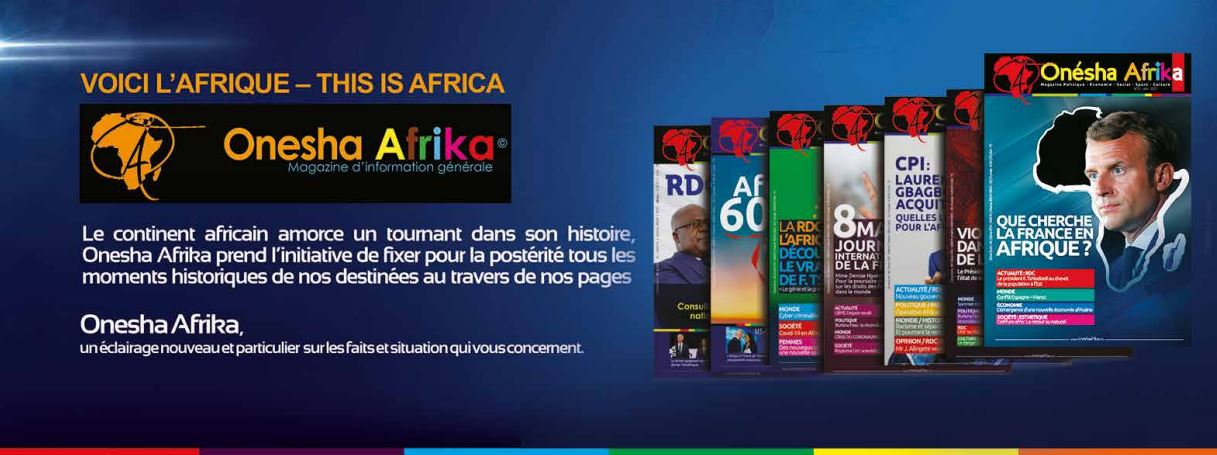(Image : presidence)
Alors que les combats se poursuivent dans l’Est de la République démocratique du Congo, le Président Félix Tshisekedi a étonné avec les signaux d’ouverture envers son homologue rwandais, le 9 octobre à Bruxelles. Une inflexion diplomatique qui semble s’expliquer par une combinaison de facteurs, politiques, militaires et économiques, sur fond d’enlisement du processus de paix.
Alors que « la main tendue » du chef de l’État congolais Félix Tshisekedi à Paul Kagame continue de faire couler l’encre, même après avoir expliqué en personne que, de nature, la RDC « n’est pas un pays va-t-en guerre » et que de toutes les façons « faire la paix n’est pas une faiblesse », il était important de rappeler les faits.
Le 27 juin, un Accord de paix a été signé entre Kinshasa et Kigali à Washington, sous médiation américaine. Mais, plus de trois mois plus tard, la situation sur le terrain reste inchangée. L’armée congolaise a perdu plusieurs positions stratégiques dans la province du Sud-Kivu : la cité de Nzibira, dans le territoire de Walungu, ainsi que les localités de Luntukulu, Chulwe et Lubimbe. De même, les affrontements se sont intensifiés dans les territoires de Walungu et de Kabare, à la limite avec Mwenga et Shabunda.
Pour les autorités congolaises, ces revers militaires dépassent les capacités du mouvement rebelle AFC/M23. Kinshasa estime que ce groupe ne dispose ni des effectifs ni de la logistique nécessaires pour résister à son armée nationale, y compris face aux frappes aériennes. Le gouvernement persiste donc à accuser Kigali d’être derrière ces avancées rebelles. Dans ce contexte, la RDC refuse de signer le cadre économique régional prévu par l’accord de Washington, arguant que le Rwanda maintient encore ses troupes sur son sol.
Même si, et c’est dans son ADN, le Rwanda rejette ces accusations, renvoyant la responsabilité à Kinshasa et dénonçant la persistance de liens entre les Forces armées de la RDC (FARDC) et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), un groupe armé rwandais hostile au régime de Paul Kagame, il est bon de savoir que ce subterfuge ne repose sur aucune menace. Les FDLR n’ont jamais attaqué Kigali depuis 1994 et, Dieu sait sait si les génocidaires sont toujours en vie, notamment avec l’âge et après les différentes incursions de l’armée rwandaise dans l’est, officiellement et frauduleusement, depuis les événements malheureux au Rwanda en 1994.
L’argument des FDLR, un mensonge érigé en système de gestion de l’État
Pire l’armée rwandaise a occupé l’est de la RDC pendant plus de 10 ans sans discontinuer, derrière ses supplétifs de l’AFDL coachée par le général rwandais James Kabarebe puis du RCD (1996-2001), du CNDP de Nkundabatware puis du M23 (2012-2013) et du M23bis depuis 2021, sans toutefois attraper un seul élément des FDLR. Preuve que la fuite derrière l’argument ne procède que du mensonge, reconnu par tous les analystes comme élément central de la politique rwandaise.
La première étape d’une opération censée démanteler les liens supposés entre les FARDC et les descendants des génocidaires a été menée unilatéralement par l’armée congolaise qui a annoncé la reddition de ces éléments début octobre, sans que Kagame puisse à son tour retirer ses troupes tapies derrière le M23.
À cette impasse militaire s’ajoute un calcul économique. Félix Tshisekedi sait que le partenariat minier voulu par Washington ne concerne pas uniquement la RDC. Kigali y figure également. Et sur ce terrain, les résultats sont tangibles, particulièrement au profit du Rwanda. Fin septembre, les États-Unis ont reçu leur première cargaison de tungstène en provenance du Rwanda, même s’il est de notoriété publique qu’il n’en possède pas dans son sous-sol.
À Kinshasa, ce contraste alimente un sentiment de frustration, alors que le pays peine à stabiliser ses zones minières de l’est et que son voisin pilleur engrange déjà les bénéfices d’un accord similaire avec Washington.
Mais le blocage principal reste politique. Le président congolais n’a jamais été preneur d’un dialogue direct avec l’AFC/M23. Pour lui, négocier directement avec « les pantins » est une ligne rouge qu’il refuse de franchir. En août 2024, lorsque le Kenya pilotait encore la médiation régionale, l’AFC/M23 avait été exclue des discussions, conformément à la position de Kinshasa. Mais à Luanda et à Doha, le Rwanda a posé ses conditions : pas de poursuite du dialogue sans la participation du mouvement rebelle. Un aveu tacite que c’est bien Kigali qui pilote la machine terroriste.
Félix Tshisekedi veut désormais accélérer en pointant la responsabilité de Kagame

Résultat : le processus est devenu pour Kinshasa un passage obligé, mais non souhaité. Le gouvernement redoute que les thèmes que l’AFC/M23 souhaite aborder à Doha (gouvernance, décentralisation, intégration des combattants) touchent à des aspects constitutionnels et remettent en cause la légitimité du pouvoir central.
Fin septembre, l’envoyé spécial américain Massad Boulos reconnaissait la complexité du dossier. « Il y a neuf grands domaines de focus. Certains prendront du temps, d’autres peuvent être réglés en quelques semaines. Certains sont d’ordre constitutionnel », avait-il expliqué.
Félix Tshisekedi veut désormais accélérer. Il est convaincu que si Paul Kagame s’implique personnellement, l’AFC/M23 pourrait être affaiblie, voire neutralisée. Mais Kigali reste complice des rebelles. Ce vendredi matin, le gouvernement rwandais a rappelé sa position : « La paix en RDC ne pourra être atteinte qu’en s’engageant dans des négociations avec le mouvement rebelle AFC/M23, conformément au processus de Doha auquel la RDC a accepté de participer ».
Dans sa campagne contre Kigali, Félix Tshisekedi ne rate pas une occasion pour indexer son homologue rwandais. L’occasion s’est présentée à Bruxelles et il n’a pas loupé l’homme. « On savait que la main tendue ne serait pas reçue de manière positive. Aujourd’hui, le monde sait quelle est la responsabilité de Paul Kagame dans ce qui arrive dans cette région », a expliqué à RFI un conseiller de Félix Tshisekedi.
La Dynamique Mashariki Plus plaide pour des actions d’apaisement visant la réconciliation nationale

C’est dans le même cadre des violences que la Dynamique Mashariki Plus, une asbl de monitoring sur la gouvernance et les intérêts de l’Est de la RDC, comprenant les provinces des deux Kivu, du Maniema, de l’Ituri et du Grand Katanga, a tenu une conférence de presse participative, le 4 octobre au Press Club Europe à Bruxelles, sur l’état des lieux de la gouvernance dans ces parties du territoire congolais.
Autant le président de Mashariki Plus Belgique, M. Abraham Chabo, que son porte-parole M. Emmanuel Luangy, sont intervenus sur les affres que vivent les populations, privées de banques et dont les activités commerciales sont en berne, de même qu’elles ne peuvent bénéficier de la jouissance totale de leurs économies suite à la fermeture des établissements bancaires.
Sous la modération de la représentante pour le Royaume Uni, Mme Pamela Grâce Tshisinga, venue expressément pour la circonstance, les deux intervenants sont revenus sur la persistance des fractures politiques et d’un langage haineux non sanctionné, appelant à un dialogue national inclusif tel que prôné par les pères spirituels des Églises catholique et protestante, en vue de sortir le pays du boulet de périodes troubles et des violences qu’il traîne depuis trois décennies. Les doyens de la Société civile du Sud-Kivu ont également formulé une demande similaire le 15 octobre, dans un message adressé au Président Tshisekedi.
Dans le même chapitre, la conférence de Mashariki, a soulevé la question de savoir si, dans un climat où l’espoir des populations des territoires occupés a cédé à l’incertitude, la « condamnation à mort » de l’ancien président Joseph Kabila, que la Dynamique qualifie de « décision sans précédent dans l’histoire du pays », ne vient pas raviver les rancœurs, alors que l’heure devait plutôt être à des actions d’apaisement en vue de la réconciliation nationale.